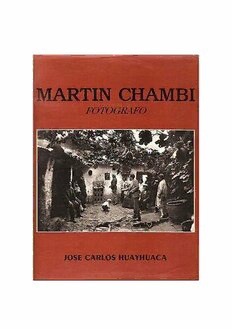Table Of Content2
SOMMAIRE
Avertissement
Remerciements
Première partie
Deuxième partie
3
Avertissement
1 Est-il normal que les relations qu’entretient tout un chacun avec sa propre société - et
particulièrement avec sa propre ville - soient si difficiles ? J’aurais tendance à penser que
oui, surtout si l’on considère ceux qui, spontanément ou pour des motifs extérieurs,
ressentent le besoin de comprendre ce qui se passe dans leur relation à soi et au monde
auquel ils appartiennent, pourquoi les choses sont ainsi et non autrement, quelle est la
cause du retour de telle ou telle situation. Un tel projet d’intelligibilité oblige à remonter
à contre-courant ou, pour le moins, à observer une pause inconfortable là où tout le
monde s’accommode du cours des choses.De là naît un sentiment de contradiction, une
espèce de noyade existentielle, une envie de ruer dans les brancards - de là viennent en
somme les difficultés.
2 Entre 1968 et 1969 -j’avais dix-neuf ans -,je me sentis tout-à-coup le besoin de régler mes
comptes avec mon univers - la ville de Cuzco -par un essai qui fixerait (dénoncerait ?) sa
personnalité complète, la publique et la privée, son côté pile et son côté face. Je ne trouvai
d’autre moyen d’y réussir qu’en étudiant les œuvres caractéristiques de la culture
cuzquénienne contemporaine, mais seulement celles qui fussent comme son expression
intense et naturelle, et dont le degré d’excellence fût indiscutable.
3 Le panorama que je trouvai me parut désespérément vide. Dans le domaine des lettres, du
cinéma, de ce qu’on appelle les beaux-arts, tout relevait - selon mon point de vue d’alors -
d’un championnat de la médiocrité... sauf l’œuvre d’un certain Martin Chambi, avec les
photographies de qui je m’étais familiarisé, presque sans m’en rendre compte, depuis
l’enfance, œuvre à laquelle je devais, autant que je pouvais le deviner, non seulement la
connaissance de tout un monde perdu ou en voie de disparition, mais aussi
l’apprentissage de certaines manières de fixer les choses et de regarder les gens.
4 De cet ancien projet, jamais mené à bien, il resta au moins quelque chose d’établi : ma
conviction que l’œuvre de Chambi était une œuvre exceptionnelle, qu’entre elle et la ville
de Cuzco il y avait une symbiose exemplaire, qu’en étudiant son cas j’arriverais
nécessairement à des significations profondes qui nous concernent tous, Péruviens en
généraletnatifsdesAndesenparticulier :n’est-cepaslepropredesmythes-etleCuzco
de Chambi en est un -, comme le dit Lévi-Strauss, "d’évoquer un passé aboli et de
l’appliquer comme une grille sur la dimension du présent afin d’y déchiffrer un sens où
4
coincident les deux faces -l’historique et la structurelle - qui oppose à l’homme sa propre
réalité" ?
5 Ces perspectives à peine entrevues furent le germe du livre que voici. L’envie de les
développer et le désir de goûter avec les autres une sélection variée, faite avec cohérence,
de l’œuvre photographique de Chambi firent le reste.
6 Le texte qui précède les images n’est pas une monographie mais plutôt un essai, genre
qui, comme on sait, sans exclure la rigueur et le souci de l’information exacte, admet les
hypothèses audacieuses - quand elles sont productives et que rien ne vient les démentir -
ainsi que l’inventivité (ou la liberté) dans l’association des idées - lorsqu’elles ne sont pas
le fruit du caprice mais qu’elles viennent jeter leur clarté sur le sujet. L’usage
systématique de la première personne du singulier est également une ressource propre à
l’essai, un tant soit peu déplaisante en général, mais qui, à mon sens, se justifie quand
l’écrit s’autorise d’une aventure personnelle et non d’une simple recherche de
commande.
7 Je me permets d’attirer l’attention sur ceci : qu’au seuil de l’an 2000 un intellectuel
péruvien de nom indigène dédie un livre à l’œuvre d’un grand artiste péruvien de nom
également indigène, et que cette initiative soit accueillie et même encouragée comme une
chose nécessaire, revêt - pour le Pérou d’aujourd’hui - une signification que je considère
comme capitale d’un point de vue culturel, social et même politique. L’histoire - dit
Borges - a ses pudeurs et il lui plaît de cacher certains de ses épisodes les plus
significatifs ; peut-être - pour ce qu’implique ce que je viens d’avancer - s’agit-il de l’un de
ceux-là, au sein de la culture péruvienne actuelle. C’est le privilège du lecteur de
confirmer ou de rejeter cette hypothèse.
5
Remerciements
1 Un livre comme celui-ci est habituellement le résultat de la collaboration de nombreuses
personnes, mais il arrive souvent que ces contributions ne soient pas toutes reconnues à
leur juste valeur, par négligence involontaire. Au risque de tomber dans les mêmes
omissions, je tiens à exprimer ma gratitude à Jean Claude Bertho, Directeur Général du
Banco de Lima, qui accueillit avec générosité l’idée de produire ce livre et accepta avec une
constante bonne volonté les requêtes qui lui furent présentées au fur et à mesure du
déroulement du projet ; à Christian de Muizon, Directeur de l’Institut Français d’Etudes
Andines, qui - à peine arrivé à Lima - accepta de co-éditer l’ouvrage et se chargea des
problèmes de logistique en leur apportant une solution efficace ; à Julia et Teo Alain
Chambi, respectivement fille et petit-fils de Martίn, sans l’approbation et l’aide
affectueuse de qui ce projet n’aurait pu prendre corps. Enfin, tout spécialement, un abrazo
de reconnaissance à Daniel Lefort, Conseiller culturel de l’ambassade de France au Pérou
et très cher ami, grâce à qui le projet put se préciser dans sa conception, se réaliser dans
ses aspects pratiques et trouver une chaleureuse sympathie tout au long de sa
progression.
6
Première partie
PORTEUR DE CHICHA A TINTA, Sicuani 1940
7
CLOCHERS DE CUZCO, Cuzco 1930
MACHUPICCHU, VUE PANORAMIQUE, Cuzco 1934
8
AUTOPORTRAIT DE MARTIN CHAMBI A MACHUPICCHU, Cuzco 1935
1 Dans les années soixante, et malgré son âge avancé, Martin Chambi était une figure
familière qui parcourait d’un bout à l’autre les rues de Cuzco à la recherche de quelque
détail significatif que son appareil n’avait pas saisi auparavant, ou de quelque angle
nouveau soudain entrevu. Et dans son vieux studio de la rue Marqués, bien qu’il eût
pratiquement abandonné l’exercice commercial de sa profession, Chambi s’amusait à tirer
le portrait des couples de jeunes mariés, des premiers communiants et même de certains
écoliers un peu frustres qui posaient indifférents sans savoir que l’un des plus grands
photographes du monde leur tirait la douzaine de photos d’identité qui finiraient au bas
de modestes relevés de notes ou d’attestations d’inscription. Et quand la maladie qui le
harcelait depuis des années eût enfin raison de lui, Chambi, sur son lit d’agonie, trouvait
le moyen de photographier les mimiques que faisait Inti, le jeune chiot qu’avait reçu en
cadeau l’un de ses petits-enfants.
2 Qu’au soir de sa vie le vieux photographe s’accrochât avec tant d’ardeur à sa vocation
nous donne une idée de l’intensité volcanique de sa passion pour l’art de la boîte noire
pendant ses années de formation et sa période d’apogée. La preuve ? Une œuvre
photographique immense qui est à la fois un objet esthétique, un document historique et
une auscultation impartiale du cœur contradictoire de la société cuzquénienne accablée
par un féodalisme séculaire, un climat rude et ombrageux, une géographie accidentée et
un passé de grandeur perdue, des hommes virtuellement constructifs mais paralysés par
des passions qui presque jamais ne convergent et parfois n’arrivent même pas à
s’exprimer.
3 Aujourd’hui, le travail de Chambi est enfin pleinement reconnu. Des admirateurs de Paris,
Londres, New York, Madrid, Buenos Aires, La Havane etc.. ont organisé des expositions de
ses photographies ; des articles sur l’œuvre et son auteur sont publiés dans d’importantes
revues culturelles de nombreuses capitales du monde ; dans son pays même, ses images
9
sont si familières que, depuis plusieurs décennies, n’importe quelle publication se permet
de les reproduire sans même mentionner la référence correspondante comme si, à
l’exemple des refrains et des proverbes populaires, elles faisaient naturellement partie de
la culture péruvienne - ce qui aurait rempli Chambi de satisfaction, connaissant les
valeurs qui gouvernent son œuvre et les caractéristiques particulières qu’elle revêt.
4 Cependant, ces valeurs et ces caractéristiques n’ont fait l’objet ni d’un examen suffisant,
ni d’aucune tentative d’en donner - à la fois avec une indispensable empathie et une réelle
connaissance de l’œuvre et de son moment historique - une ébauche d’explication. Ce
texte se propose de combler cette lacune, serait- ce de manière incomplète.
Mineurs indiens de Coaza
5 L’an 1891. A Coaza, ce petit village presque féerique de la province de Carabaya, région de
Puno, vers le sud-est des Andes péruviennes, Martín Chambi voit le jour au sein d’une
famille paysanne de culture quechua* pas vraiment démunie mais qui partage avec ses
voisins le sort commun de compter avec de bien maigres moyens de subsistance, de
perpétuer un mode de vie extrêmement traditionnel et d’être l’objet d’un ostracisme
racial et culturel de la part des blancs et des métisses hispanophones qui composent la
société officielle.
6 Nous sommes dans la décennie qui suit le désastre de la guerre contre le Chili. Dans le
pays, c’est l’époque où l’on panse les blessures de la nationalité mise à mal et où l’on
ressent, par conséquent, la nécessité de changements et de réajustements de fond en
comble qui permettraient de surmonter une longue crise. Une de ces mesures - comme
cela est déjà de tradition dans l’histoire du Pérou - est d’ouvrir les portes au capital
étranger, particulièrement à celui qui cherche à s’investir dans les mines. Ainsi, les
Anglais installent et dirigent, non loin de Coaza, la Santo Domingo Mining Company qui se
consacre à l’exploitation de l’or. Comme les autres paysans, le père de Martin Chambi s’y
voit attiré pour des raisons économiques et finit par travailler occasionnellement au
profit de la mine, un sort que connaîtra plus tard Martin lui-même afin d’apporter sa
contribution aux précaires ressources de la famille.
Une issue providentielle : la photographie
7 De ce fait, une situation nouvelle commence à se créer dans toute cette zone, et il n’est
pas difficile d’imaginer les villageois agités par cette nouvelle source de travail et
s’ouvrant parallèlement - d’une manière certes très progressive - à un monde "moderne"
aux possibilités inattendues. Les Anglais, entre autres curiosités dignes de la foire, ont
apporté un appareil photographique et le gringo* qui le manipule va de-ci de-là avec son
lourd équipement de bois et de métal, fabriquant de petites images imprimées sur papier
qui reproduisent ce qu’on voit à l’aide de la lumière du jour. Il est impossible à Martin -
qui peut-être prend l’initiative de la rencontre en s’offrant à porter le pesant engin - de
résister à cette magie, et lui vient le désir de se familiariser avec elle par tous les moyens,
à tel point que son nouvel ami accepte de lui montrer les rudiments du métier, et surtout
les images qui en sont le résultat. Ainsi Martin reconnaît, bien que mis en relief d’étrange
façon, les paysages des environs, les petites maisons douillettes de Coaza, les visages
familiers de ses concitoyens paysans, des mineurs et même des Anglais. Il voit aussi des
10
images de lieux qu’il n’a jamais vu, de gens de la ville qui paraissent bien différents de
ceux qu’il a autour de lui.
8 C’est l’éblouissement. Mais c’est aussi la bouleversante occasion d’un questionnement
radical : d’abord parce qu’il voit l’étroitesse de son univers, la pénurie matérielle qui
l’accable, les différences éclatantes par rapport aux blancs qui dominent et aux gens de la
grande ville ; ensuite parce qu’il se voit, expérience qui dût être d’une importance capitale
pour lui, non pas comme une manifestation de vanité, mais plutôt comme un moyen de se
comprendre soi-même (la quasi obsession de l’autoportrait qui le poursuivit toute sa vie
durant et qui donna lieu à plusieurs chefs- d’œuvre en est probablement une
conséquence). Le terrible problème de l’identité personnelle et de ses incertitudes, que
l’on vit habituellement comme un processus, condensé ici en un dramatique instant :
l’instant où le gringo lui montra la première photo qu’il fit de lui. Ace moment- là, Chambi
dût prendre conscience, d’une manière foudroyante, de qui il était, ou pour mieux dire,
de qui il ne voulait pas être : un enfant ou un adolescent indigène à peine scolarisé (trois ou
quatre années de ces pauvres études primaires typiques de la montagne péruvienne
d’alors, qui était dépourvue de tout), destiné aux formes variées et plus ou moins
déguisées du servage vers lequel étaient dirigés les fils des paysans des Andes. Dans
l’espace de ce va-et-vient (voilà ce que je suis / voilà ce que je ne veux pas être) naquit le projet
existentiel de se construire une identité alternative, projet qui absorba une grande part
de sa vie et dont le catalyseur, le levier privilégié, de même que le langage et le moyen
d’expression, fut la photographie. On ne peut expliquer autrement l’intensité de son
rapport à elle, ni les modalités particulières selon lesquelles il la pratiqua : l’art et le
métier de la photographie comme le moyen d’une révélation de quelque chose et d’une
conversion à autre chose ; ou, pour mieux dire, comme le symbole et la possibilité de se
transcender soi-même.
AUTOPORTRAIT AVEC AUTOPORTRAIT DE MARTIN CHAMBI, Cuzco 1923